Agrégé et docteur en histoire, Jean-François Brun est enseignant-chercheur à l'université de Saint-Étienne. Colonel de réserve, auditeur de lʼIHEDN, il a participé à plusieurs OPEX dans les Balkans. Spécialiste d'histoire militaire, ses travaux portent plus spécialement sur l'organisation des armées en tant que système et sur l'évolution des armements.
Auteur d’une dizaine d’ouvrages, Franck Abed, écrivain, historien et philosophe, réalise des entretiens intellectuels depuis 2009. Celui-ci est consacré à l’ouvrage intitulé La Grande Armée - Analyse d'une machine de guerre publié chez les Editions Pierre de Taillac (editionspierredetaillac.com).
Franck ABED : Bonjour monsieur. Merci d’accepter de répondre à nos questions. Avant d’entrer dans le vif du sujet, est-ce que tout n’a pas été déjà dit et écrit sur la Grande Armée ?
Jean-Edouard Brun : L’histoire événementielle, les hommes (du soldat aux chefs) ont donné lieu à de nombreux ouvrages. Mais, curieusement, il n’y avait jamais eu d’analyse systémique de la Grande Armée. On avait beaucoup décrit les campagnes, étudié les divers acteurs ou l’enchaînement des événements mais jamais abordé la Grande Armée par le biais d’une analyse fonctionnelle, comme un système formé d’éléments en interrelation.
FA : Quelle fut votre méthode de travail tout au long de ces années pour parvenir à publier cet ouvrage remarquable et très instructif ?
J-E.B : J’ai analysé les archives de tout type disponibles : mémoires et témoignages publiés ou demeuré manuscrits, rapports et livrets d’appel conservés dans les centres d’archives, ouvrages théoriques d’époque, documents cartographiques et iconographiques. J’ai également utilisé le résultat de tests sur les armes à poudre noire et les rapports de fouilles archéologiques.
À partir de toutes ces informations, j’ai essayé de mettre en évidence les logiques qui sous-tendent l’assemblage d’hommes et d’unités destinés à constituer la Grande Armée, et les conditions de fonctionnement de l’instrument obtenu, avec ses possibilités, ses limites, ses contraintes et ses degrés de liberté (d’adaptation aux contraintes extérieures ou à l’imprévu si vous préférez).
FA : Comment présenteriez-vous la Grande Armée ?
J-E.B : Comme un instrument militaire dont l’agencement novateur intègre l’ensemble des nouveautés militaires (théoriques et pratiques) de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution. Elle est initialement en avance (en termes d’organisation d’ensemble) sur ses adversaires, mais cette avance se réduit au fil des campagnes car il y a à la fois affaiblissement de la Grande Armée (par la perte des soldats entraînés) et maîtrise progressive des formes organisationnelles nouvelles par ses ennemis. Cette double évolution explique la difficulté croissante des campagnes (côté français), jusqu’à ce que la différence d’effectif devienne le facteur clé (au deuxième semestre 1813 et surtout en 1814).
FA : De nos jours, il n’est pas rare de constater qu’il existe une confusion entre la stratégie et la tactique. De 1792 à 1815, longue période quasi ininterrompue de guerre entre les pays coalisés et la France, cette distinction était-elle déjà prise en compte par les militaires ?
J-E.B : Actuellement, on parle par ordre décroissant d’importance de « niveau stratégique » (où l’on détermine des choix militaires correspondant au but politique défini par le gouvernement), de « niveau opératif » (commandement interarmées sur un théâtre d’opérations) et de « niveau tactique » (préparation et déroulement de la bataille). À l’époque napoléonienne, on distingue mal les niveaux stratégique et opératif, globalement désignés sous le terme de « grande tactique ». La Convention (en fait le Comité de Salut Public) puis Napoléon mettent en œuvre la vision stratégique. De leur côté, les généraux en chef de la Révolution s’en tiennent tout à fait logiquement à une vision de la « grande tactique » correspondant essentiellement au niveau opératif.
Le général Bonaparte transgresse cette répartition des rôles lors de la première campagne d’Italie, lorsqu’il impose les termes de l’armistice de Loeben (ce qui le place au niveau stratégique, c’est-à-dire politique). Consul, puis Empereur, Napoléon est à la fois chef d’État et général en chef. Ses manœuvres et ses choix militaires (répartition des forces entre les divers théâtres, détermination des axes d’effort) mélangent donc les deux niveaux décisionnels les plus élevés. Mais il agit également en tacticien un jour de bataille. Bref, à la tête de la Grande Armée, il mêle les trois niveaux, ce qui est un énorme avantage (notamment en termes de raccourcissement des délais de réaction face à la situation créée par l’adversaire) mais exige en contrepartie un esprit de synthèse et une capacité de priorisation hors du commun.
Cela a deux conséquences. Étant donné que le terme « Grande Armée » désigne les forces du théâtre principal sous les ordres directs de l’Empereur, les responsables des autres théâtres sont les seuls généraux à pouvoir jouer un rôle opératif. C’est le cas en Espagne mais aussi en Italie ou en Illyrie. À la Grande Armée, en revanche, compte tenu de la présence de l’Empereur, les chefs sont essentiellement cantonnés au niveau tactique (sauf s’ils sont responsables temporairement d’une zone d’action autonome au sein du théâtre d’opérations (Davout pour le bas-Elbe lors de la seconde campagne de Saxe par exemple).
FA : Napoléon émerge, en tant que prodige militaire, lors de la Première Campagne d’Italie (1796-1797). Pouvons-nous dire qu’il avait déjà révolutionné l’art de la guerre ou cette proposition se montre quelque peu excessive ?
J-E.B : Comme toujours, il faut des circonstances favorables permettant à une personnalité d’exception d’émerger. Napoléon Bonaparte est un officier exceptionnellement doué au plan intellectuel, qui a pu étudier les penseurs militaires de la fin du XVIIIe (Bourcet, Guibert et, pour l’emploi de l’artillerie en masses puissantes du Teil). Il bénéficie également des investissements de la royauté (l’artillerie Gribeauval qui est sans doute la plus moderne de l’époque). Sa chance réside dans le « grand reset » de la Révolution, qui bouleverse la hiérarchie et les règles d’avancement et lui permet d’arriver très vite dans le petit groupe des généraux commandant des armées (sachant qu’il a su faire les choix politiques adéquats au moment opportun). Ses capacités personnelles, son audace bien plus importante que celle de ses pairs et concurrents et un peu de chance lui permettent ensuite de prendre le leadership politique et de réduire ce groupe à l’obéissance.
Possédant à fond son métier, fort d’une connaissance approfondie (et réfléchie) des théories nouvelles (notamment la rapidité de mouvement pour obtenir la concentration des forces au point clé, dans un rapport de forces favorable), il applique des solutions tactiques innovantes. Cela lui permet de s’imposer à des adversaires manoeuvrant selon des schémas traditionnels mais il ne prend réellement conscience de sa supériorité qu’après la victoire de Rivoli.
La première campagne d’Italie est la mise en œuvre raisonnée d’une série d’innovations que ses prédécesseurs, faute de culture militaire ou d’un esprit de synthèse suffisants, n’avaient pu utiliser. C’est en ce sens que l’on peut parler d’une pratique qui révolutionne le cours d’une campagne. Mais il faut y ajouter un élément difficilement quantifiable : le charisme du chef, la profonde empathie qu’il entretient progressivement avec les troupes sous ses ordres. C’est sans doute le « plus » qui lui permet de tirer un parti maximum de ses combinaisons tactiques.
En pratique, il mène une guerre d’annihilation (destruction tactique de l’adversaire par une bataille décisive résultant de marches-manœuvres et donnant lieu à une poursuite coûteuse pour le vaincu) plutôt que la guerre d’attrition pratiquée par ses adversaires (à l’image de Frédéric II quelques décennies plus tôt). Il fait montre, parallèlement, d’une exceptionnelle capacité à déterminer le point décisif ou l’unité dont la prise ou la destruction tactique déséquilibreront le dispositif général adverse. Mais tout affrontement ou toute bataille se caractérisent par l’interactivité. Son exceptionnelle rapidité d’analyse et de réaction lui permet à cet égard de prendre de vitesse l’ennemi et de lui imposer sa propre manœuvre et donc sa propre temporalité (Foch dirait de lui imposer sa « volonté »).
Je crois cependant qu’il faut, pour répondre complètement à votre question, élargir la période considérée. En Italie, le général Bonaparte ne dispose que de moyens limités. Il met en œuvre ses conceptions avec des divisions. Devenu Premier consul, la seconde campagne d’Italie en 1800 lui fournit l’occasion de manœuvrer avec des embryons de corps d’armée. Mais c’est à Boulogne qu’il organise réellement son instrument militaire avec des unités de manœuvre de 1er rang (corps d’armée) et de 2e rang (divisions). Dès lors, on peut parler de révolution dans l’art de la guerre puisqu’il met sur pied un instrument militaire (la Grande Armée) en fonction d’une doctrine d’emploi (c’est la même chose en 1981 lorsque les États-Unis adoptent la théorie de l’Air Land Battle et restructurent leur armée).
Dès lors, c’est sans doute dans la combinaison de cette faculté à organiser un instrument militaire et de sa supériorité tactique due à sa rapidité de raisonnement et de synthèse que réside sa supériorité sur tous ses adversaires.
FA : Vous écrivez que « la réflexion militaire française distingue trois éléments de base, théorisés notamment par Foch dans la droite ligne de la tactique napoléonienne : concentration des efforts, liberté d’action et économie des forces ». Le dernier élément paraît quelque peu surprenant, notamment quand nous connaissons les hécatombes de La Moskowa, Leipzig, Verdun et La Marne. Qu’en pensez-vous ?
J-E.B : Vous évoquez ce que j’appelle le triangle de la manœuvre. Dans un triangle, le total des angles est toujours de 180°. De même, ici, les trois termes que vous citez sont interdépendants. Mais il faut définir précisément les notions. L’économie des forces ne désigne pas le taux de perte mais l’utilisation du minimum de troupes pour une action, ce qui permet de constituer avec le surplus inutilisé une réserve offrant la possibilité de réagir à une manœuvre inattendue (ce qui n’est autre que la conservation de la liberté d’action) et d’obtenir un rapport de force favorable au point-clé (concentration des forces).
En fait, la manœuvre sur un théâtre ou sur un champ de bataille vise à obtenir au moment voulu un rapport de force favorable (généralement 3 contre 1 pour une action offensive). C’est là une condition nécessaire (mais pas forcément suffisante) pour envisager d’obtenir la victoire (sachant que le hasard et les impondérables sont toujours présents, d’où la précaution d’une réserve).
Si l’on revient sur la question des pertes, il faut les relativiser et tenir compte des effectifs et de l’impact de la guerre sur la population. La France mobilise un cinquième de sa population lors de la Première Guerre mondiale, l’Empire 7% seulement, ce qui explique qu’entre 1800 et 1814, la population française (sans tenir compte des annexions territoriales) connaît un croît naturel.
Les batailles sont généralement moins meurtrières que de nos jours tout simplement parce que les effets du feu (essentiellement de l’artillerie) sont infiniment moindres. Le gros des pertes des armées provient de la maladie (des « fièvres ») jusqu’à ce que la révolution pasteurienne change la donne.
Si l’on reprend les deux cas cités, La Moskowa a entraîné des taux de perte supérieurs à ceux d’Austerlitz car la manœuvre a été peu employée pour diverses raisons. Ce n’est à cet égard pas une bataille spécifiquement napoléonienne (qui ressemble à un combat de judo) mais plutôt un match de boxe (comme Verdun, toutes proportions gardées). Leipzig de son côté est un affrontement célèbre par la puissance de l’artillerie déployée mais, par la manœuvre, Napoléon contient lors de la première journée des ennemis bien supérieurs en nombre. Il décide ensuite de retraiter car ses caissons de munitions sont pratiquement vides et la destruction du pont par lequel s’effectue le repli entraîne un désastre.
FA : Depuis très longtemps, une phrase écrite par le Maréchal Marmont a retenu mon attention : « Nous avons fini par perdre, mais nous les avons fait danser pendant quinze ans ». La domination des armées napoléoniennes s’explique-t-elle par la supériorité de Napoléon ? De l’encadrement ? Des soldats ? De l’armement ?
J-E.B : La domination des armées napoléoniennes s’explique vraisemblablement par une combinaison de facteurs. Sa structure organisationnelle (des corps d’armée, une réserve de cavalerie et un Grand parc qui constitue un arsenal mobile) lui permet de manœuvrer efficacement sur l’ensemble du théâtre et de se concentrer très rapidement au point choisi (sachant que tous les corps d’armée ne sont pas présents lors de la bataille décisive ; certains retiennent en effet ailleurs une partie des forces adverses). C’est cette organisation qui est progressivement imitée par l’adversaire (« réveil » militaire autrichien, réforme de l’armée prussienne et, dans une moindre proportion, de l’armée russe). Ces modernisations annulent petit à petit l’avantage français et rendent les campagnes moins décisives pour Napoléon.
L’entraînement et l’accoutumance à ces nouvelles structures entrent également en ligne de compte. Les mois passés au camp de Boulogne sont cruciaux et participent de la supériorité de l’armée française en 1805. Mais là aussi les pertes et l’accroissement des effectifs (qui suppose l’intégration de nouveaux soldats moins bien formés ou d’un certain nombre de contingents alliés peu motivés) amènent une diminution de la capacité manœuvrière (de la « qualité » de l’instrument militaire).
Vient ensuite l’indéniable supériorité « professionnelle » de Napoléon qui combine ses manœuvres et réagit plus rapidement et plus efficacement que les chefs ennemis, tant lors des opérations préliminaires que lors de la bataille. Mais, avec l’âge, il est moins résistant physiquement et donc un peu moins actif en campagne. Quoiqu’il en soit, sa supériorité en termes de capacités de commandement ne parvient pas à compenser, à la fin de l’Empire, la supériorité numérique adverse (1814) tandis que l’accroissement des effectifs le contraint à déléguer de plus en plus le commandement de fractions importantes de l’armée à des subordonnés qui ne possèdent pas les qualités dont il fait montre et qui sont donc au même niveau que les chefs adverses. Ces derniers peuvent dès lors jouer sur leur supériorité numérique ou la meilleure qualité de leurs troupes (c’est le cas en Espagne ou lors de la 2e campagne de Saxe en 1813).
Enfin, il y a le facteur moral, déjà évoqué. Le patriotisme et l’attachement au chef militaire sont indéniables lors des premières campagnes (1805 mais aussi 1806-1807). Puis, la transformation en armée multinationale, et peut-être l’éloignement progressif des idéaux révolutionnaires affaiblissent vraisemblablement la cohésion alors que le mouvement inverse intervient chez les adversaires (pensons au sentiment patriotique qui se développe en Allemagne et aux volontaires que cela procure en 1813, ou à la volonté de défendre la patrie et l’orthodoxie au sein des troupes russes. La Moskowa/Borodino est à cet égard l’équivalent notionnel de Valmy).
La qualité de l’armement n’intervient pas (les moyens sont globalement analogues de part et d’autre). Napoléon n’a pas innové (il a même abandonné le ballon d’observation et refusé le sous-marin), préférant utiliser des matériels qu’il connaît et jouer plutôt sur la capacité manœuvrière de ses troupes.
FA : Certains opposent la Campagne d’Italie et la Campagne de Russie en se basant sur les éléments suivants : taille du terrain (petits espaces vs immensité de la steppe), Napoléon (général républicain maigrichon vs l’Empereur bedonnant), armée française d’Italie vs armée des 20 nations. Est-ce qu’il s’agit de critères pertinents pour expliquer la victoire et la défaite des campagnes militaires précédemment citées ?
J-E.B : Tous ces éléments sont vrais mais c’est leur combinaison, sur fond de faillite logistique, qui amène la défaite. Une fois de plus, « le Tout excède la somme des parties » et les effets de ce Tout prennent un tour propre.
L’espace géographique en termes de dimensions et de ressources est sans doute l’élément le plus important. Alors que la relative exiguïté de l’Italie du Nord permettait des mouvements de concentration rapides, ce n’est plus le cas en Russie. L’espace est d’abord un obstacle au commandement centralisé et aux concentrations minutées car les élongations accroissent énormément les étapes et les difficultés de liaison (on n’a que des courriers à cheval). L’espace permet ensuite aux troupes du tsar de retraiter loin en arrière, ce qui accroît les lignes d’approvisionnement de Napoléon et transforme la campagne courte en une campagne qui dure (avec là encore les difficultés nées de la tactique de la « terre brûlée » qui joue sur l’une des vulnérabilités de la Grande Armée, sa faiblesse logistique qui suppose des campagnes courtes et le recours aux ressources locales). C’est très différent de l’Italie qui offrait toujours des ressources à une armée infiniment plus faible en effectifs.
L’implication des soldats, leur « moral », est aussi très différente. L’armée d’Italie est nationale et révolutionnaire. Elle part à la conquête de richesses au nom de la Liberté et de l’Égalité. Mais, en Russie, les détachements alliés sont peu motivés, voire jouent leur carte nationale (comme les contingents prussien ou autrichien). En face, l’adversaire n’est pas le même : l’armée sarde ou les troupes autrichiennes n’ont pas réellement d’intérêt patriotique à défendre les divers États italiens (ils s’imaginent encore dans les guerres princières du XVIIIe où l’enjeu est un accroissement territorial limité). En Russie, en revanche, les troupes du tsar sont animées d’un fort sentiment patriotique : elles luttent pour le pays et l’orthodoxie et acceptent tous les sacrifices. Ce n’est pas pour rien que la campagne de 1812 est connue sous l’appellation de « guerre patriotique » (la « Grande guerre patriotique » étant la Seconde guerre mondiale).
La moindre résistance physique de Napoléon, en Russie, ne me semble pas déterminante (du moins pas comme en 1813 ou 1815). Il peut s’appuyer sur l’instrument sans pareil qu’est son Grand État-Major. Son problème réside dans une estimation erronée de la volonté de résistance russe et dans sa capacité tactique à retraiter (on en revient à l’échange de temps contre de l’espace), dans un début de campagne un peu tardif.
Tout cela s’ajoute et finit par faire de la Grande Armée un instrument lourd à manœuvrer et difficile à nourrir. La décision de tenter un raid sur Moscou, plutôt que d’hiverner à Smolensk, est un coup de poker fondé sur une appréciation erronée de la capacité de résistance du pouvoir russe. La décision de ne pas hiverner à Moscou procède pour une part de considérations politiques.
Bref, on est confronté à deux cas de figures très différents. En 1796, un général avec une petite armée motivée, une tactique novatrice et une absence d’enjeu politique sur un théâtre restreint. En 1812, la lutte de deux empires avec des moyens en conséquence et un espace surdimensionné face aux moyens disponibles.
FA : La Guerre d’Espagne (1808 - 1814) fut dévoreuse d’hommes, d’argent et d’énergie pour l’Empire. Elle est souvent présentée comme un conflit asymétrique alors que les armées napoléoniennes affrontèrent également des troupes régulières (contingent britannique, armée portugaise). D’une manière générale, la Grande Armée pouvait-elle remporter ce conflit si particulier ?
J-E.B : On a souvent parlé du « cancer espagnol ». En fait, on a interpénétration de deux types de conflits, qui obéissent à deux logiques différentes mais conjuguent leurs effets face à l’adversaire commun.
En Portugal et progressivement en Espagne, les troupes impériales sont opposées à une armée régulière anglo-portugaise (progressivement renforcée d’unités espagnoles). C’est la guerre classique, le conflit symétrique, qu’il est possible de gagner (mais les maréchaux et généraux en chef font souvent cavalier seul et ne se haussent pas au niveau tactique de Wellington). Néanmoins, les règles appliquées entre adversaires (le droit des conflits armés) s’avèrent comparables à celles usitées lors des campagnes d’Allemagne ou d’Autriche.
Parallèlement, dans une grande partie de l’Espagne, les forces impériales constituent une armée d’occupation confrontée à des phénomènes de collaboration et de résistance (notamment de résistance armée). On est là dans un conflit asymétrique avec, par exemple, insécurité des axes de communication, attaque de convois, opérations contre les « maquisards » (le terme est volontairement anachronique, mais permet de décrire la réalité) tandis que la Junte joue le rôle d’un gouvernement provisoire puisque le roi légitime est prisonnier. La Grande Armée, très clairement, n’est pas faite pour cette mission (elle est organisée pour lutter contre une armée régulière). D’où ses difficultés (d’autant que l’Espagne est un parent pauvre dans la répartition des forces). D’où également les exactions de part et d’autre car l’on n’est pas dans un conflit « régulier » et donc aux comportements régulés. Ce sont les « malheurs de la guerre » de Goya. Le seul à essayer de pacifier réellement la région qui lui est confiée est Suchet (seul également à gagner un bâton de maréchal en Espagne), les autres chefs militaires se préoccupant davantage de la guerre régulière contre les Hispano-britanniques ou considérant leur zone comme la base arrière des troupes de campagne que l’on s’efforce d’opposer à Wellington.
Il est probable que l’absence d’un commandement unique en Espagne a été une grande faiblesse au plan militaire. Mais, avec les moyens dont elle disposait, son recrutement allié pour partie et sa structure organisationnelle, l’armée d’Espagne ne pouvait résoudre par la force le problème espagnol qui est d’abord politique et marqué par l’absence de toute légitimité de la présence française.
FA : Pourriez-vous présenter dans les grandes lignes une bataille à l’époque napoléonienne ?
J-E.B : Il faut partir d’un constat préalable. Une bataille est un affrontement interactif, où toute action suppose une réaction adverse, à laquelle il va falloir répondre. La liberté d’action du chef réside alors dans la possession d’une réserve qui lui permet de répondre à l’imprévu. Le principe napoléonien, extrêmement logique (et toujours en vigueur) consiste donc à contraindre l’adversaire à utiliser toutes ses unités, y compris ses réserves, tout en conservant lui-même une réserve qui permettra d’engager une action à laquelle l’adversaire ne pourra plus s’opposer (et qui deviendra de ce fait décisive).
Concrètement, une bataille commence par une phase de fixation de l’adversaire. De façon pragmatique, l’Empereur tente de petites attaques ou des mouvements offensifs sur divers points du front, sans vraiment d’idée préconçue. Lorsqu’il a le sentiment que l’adversaire n’a plus les moyens de réagir, il lance une attaque décisive sur ce qu’il estime être le point -clé (le point faible) du dispositif adverse. La phase de fixation est extrêmement longue (7 heures à Austerlitz), l’attaque décisive plus courte (1 heure à Austerlitz).
Cela nous amène à la façon dont s’achève la bataille. Ce n’est pas caedes (le massacre) des batailles antiques où les hoplites qui ont plié sont poursuivis et tués par l’adversaire. En fait, l’attaque décisive, à l’époque napoléonienne, aboutit à détruire un élément du dispositif de l’adversaire. Ce dernier, incapable de rétablir la situation sur ce point, est alors contraint de retraiter plus ou moins en désordre afin de « limiter les dégâts » car résister sur place signifierait la destruction de l’armée, partie par partie. Ainsi, le fait de s’emparer du plateau de Pratzen, à Austerlitz, permet de couper l’armée austro-russe en deux et, en rabattant une partie de la Grande Armée sur l’aile sud, de détruire dans ce secteur les troupes austro-russes, prises entre les unités qui les attaquent et le corps d’armée de Davout, qui sert de butoir. Dans ces conditions, pour éviter l’anéantissement, le centre et l’aile nord austro-russe préfèrent retraiter, laissant à leur sort les troupes au sud.
Mais la bataille n’est pas une fin en elle-même. Il faut la réintégrer dans le déroulement d’ensemble de la campagne. Les marches-manœuvres, durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, forment une première phase qui vise à amener la majeure partie de la Grande Armée face à la majeure partie de l’ennemi pour une bataille décisive (2e phase). La victoire permet de s’emparer de la route logistique adverse mais surtout de profiter de la désorganisation des vaincus pour les poursuivre. C’est la troisième phase de la campagne et la plus importante car elle permet de tirer les bénéfices de tout ce qui précède. La plus célèbre poursuite (et la plus rentable) est celle menée aux dépens des Prussiens en 1806, qui aboutit à la capture de la plupart des unités ayant échappé à la double défaite de Iéna-Auerstaedt. Mais c’est une opération raisonnée, avec des mouvements calculés combinant l’action de plusieurs corps d’armée. Manquer la poursuite équivaut à perdre le bénéfice de la campagne, comme en juin 1813. L’ennemi ne s’avoue pas définitivement vaincu et se réorganise.
FA : Le concept de bataille décisive, pour évoquer les batailles victorieuses remportées par Napoléon mettant fin à une campagne militaire, est-il légitime ou usurpé ?
J-E.B : Je crois que c’est a posteriori que, dans la plupart des campagnes, une bataille importante, voire générale, se voit qualifiée de décisive. Accoler ce qualificatif à une rencontre, c’est reconnaître qu’elle constitue la défaite qui, pour le vaincu, lui ôte tout espoir de victoire, au moins dans la campagne considérée, et le contraint à traiter ou, au minimum, à retraiter dans un dispositif plus ou moins ordonné, générateur de pertes inévitables (y compris, et peut-être surtout par reddition d’éléments isolés).
Napoléon, conscient de sa supériorité tactique, s’efforce d’amener, par ses marches, son ennemi à livrer une bataille de grande ampleur. En cas de victoire, l’Empereur est ainsi en mesure d’achever la campagne rapidement. La brièveté du conflit est en effet une contrainte de son système de guerre, le corollaire de la légèreté (notamment en termes logistiques) qui permet la rapidité (facteur de supériorité dans la manœuvre et donc facteur de victoire).
L’analyse nous montre cependant que la bataille décisive intervient à des moments très différents dans le cours des diverses campagnes (chacune d’elles constitue un cas d’espèce). Parfois, il n’y en a pas : l’affrontement longuement recherché en Russie, intervient à La Moskowa/Borodino sans rien de décisif. De même, dans la campagne de France, les coalisés évitent soigneusement la bataille générale et jouent sur leur énorme supériorité numérique pour mettre en œuvre une sorte de « tactique par étouffement » qui est totalement payante. Parfois également, la bataille décisive se retourne contre Napoléon (à Waterloo par exemple).
Je crois qu’en histoire des conflits, il serait plus pertinent de parler de point de rupture de l’équilibre (généralement par le biais d’une bataille), suscitant au profit d’un camp une dynamique de la victoire (contrebalancée pour l’autre camp par une dynamique de la défaite).
FA : Les sièges sont rarement évoqués lorsque nous étudions les campagnes napoléoniennes. Étaient-ils des anachronismes ou une composante essentielle des guerres napoléoniennes ?
J-E.B : Guerre de position et guerre de mouvement sont les deux visages du Janus que constitue un conflit classique. Les sièges ne sont que l’aspect le plus spectaculaire de cette guerre de position. Ils ont été nombreux dans les guerres napoléoniennes.
Concrètement, l’on connaît les grands sièges que les troupes impériales mènent, généralement pour s’emparer de villes importantes qui servent de dépôt logistique majeur à l’ennemi (Danzig) ou constituent un point de résistance du vaincu (Gaëte ou Cadix, qui est un échec). Dans le déroulé des campagnes napoléoniennes, on pourrait schématiquement dire que les troupes impériales assiègent les places lors des campagnes victorieuses et défendent les places au cours des campagnes malheureuses (1813 et 1814, aussi bien en Allemagne qu’en Espagne et dans les Provinces illyriennes).
Si l’on élargit l’analyse, il est évident que la stratégie impériale prend en compte la possession de places-clés dans la gestion de la défense de l’Empire (occupation des places de l’Oder qui garantissent le passage du fleuve pour amener des troupes de la Confédération du Rhin au grand-duché de Varsovie).
Mais, au-delà du gage politique et de la précaution stratégique, l’édification de défenses permet, au point choisi, d’économiser des troupes (on acquiert une supériorité défensive qui contraint l’adversaire à masser des effectifs supérieurs), ce qui libère mécaniquement des forces pour attaquer ailleurs. On constate ainsi, par exemple, au niveau opératif, la constitution d’une barrière fortifiée avec des places fortes complétées de redoutes de campagne (cas de l’Elbe en 1813). De même, sur le champ de bataille, l’aménagement du terrain n’est pas absent (le Santon à Austerlitz, la Grande Redoute à Borodino, la ferme d’Hougoumont à Waterloo).
Concrètement, il y a eu de nombreux sièges, de 1805 à 1814 mais la mémoire ne met en avant que les plus célèbres, c’est-à-dire généralement les plus importants. La grande différence avec les guerres antérieures réside dans le statut accordé aux villes fortes. Au début du XVIIIe, l’acquisition de gages territoriaux demeure l’objectif primordial et les batailles sont souvent liées à un siège (une armée de couverture de la force assiégeante rencontrant une armée venant au secours des assiégés). La priorité s’inverse dans les guerres napoléoniennes. Le siège n’est qu’un aspect secondaire de la manœuvre car l’objectif premier est d’abord la destruction de l’armée adverse.
FA : La logistique et les services de santé connurent-ils des véritables mutations lors de l’époque napoléonienne ?
J-E.B : Il faut sans doute apporter une réponse nuancée à votre question. La Grande Armée fonctionne un peu à la manière d’un corps expéditionnaire qui doit avoir les moyens de mener une campagne en utilisant partiellement les ressources locales (vivres, moyens de traction…). Le « Grand Parc d’artillerie, du génie et des équipages » est une sorte d’arsenal mobile, avec des réserves de munitions et de matériel et des unités spécialisées capables de réparer armes et voitures.
Par ailleurs, le fondement des manœuvres napoléoniennes réside dans la rapidité de déplacement (qui permet des concentrations inattendues ou donne l’opportunité de couper la ligne d’opération adverse, c’est-à dire l’itinéraire qui joint l’avant et l’arrière). Dès lors, la capacité de mobilité est primordiale. Napoléon l’a organisée systématiquement (alors que ses ennemis ne disposent pas, initialement, de structures analogues). Il a mis sur pied des trains (des transports) militarisés dans les divers domaines : train d’artillerie (1800), train du génie (1806), train des équipages (1807), sachant qu’il renforce ces unités de moyens réquisitionnés si la nécessité s’en fait sentir. Statistiquement, on a un cheval pour 4 hommes dans les armées de campagne napoléoniennes (ce qui est un ratio comparable au nombre de véhicules par hommes dans les armées occidentales du deuxième XXe siècle).
Comme de nos jours, la logistique (l’approvisionnement) d’une armée se répartit en deux grands domaines : les convois de munitions d’artillerie et les convois de vivres. Pour alléger ces derniers, la Grande Armée vit en partie sur les ressources locales grâce à un système de ponctions très bien organisé (taxes levées sur les collectivités par l’intermédiaire des autorités ennemies, ce qui permet de payer une partie des réquisitions, mais également réquisitions en nature de chevaux, de souliers, de pain, de viande…). Comme la Grande Armée est relativement sobre, le système fonctionne bien en Allemagne (mais lorsque les ressources locales manquent, en Pologne ou en Russie, la faillite est patente).
Une véritable manœuvre logistique double ainsi la manœuvre tactique proprement dite, tandis qu’une chaîne d’entretien et de réparation (compagnies d’ouvriers d’artillerie ou du train compagnies d’armuriers…) permet de limiter durant la campagne l’attrition des armes et des véhicules. Au bout du compte, ce sont tous ces éléments qui rendent la Grande Armée si moderne, et lui assure une avance organisationnelle sur les armées adverses durant plusieurs années.
La question du service de santé est un peu différente. On est face à deux problèmes très différents. Il s’agit d’abord de maintenir le maximum d’homme sur les rangs, ce qui est une question de santé publique : lutte contre les épidémies ou les maladies saisonnières, en établissant notamment des camps et des cantonnements dans des lieux sains, en nourrissant suffisamment les soldats, en les soignant correctement dans des hôpitaux bien organisés (qui ont un taux de mortalité, donc un rendement, comparable à celui des établissements civils). C’est essentiellement le rôle des médecins.
Mais une armée de campagne est faite pour combattre. La bataille contraint à pratiquer, dans des postes de secours, une véritable médecine d’urgence, avec un afflux brusque d’un nombre extrêmement important de patients plus ou moins gravement atteints (le gros problème demeurant le relevage des blessés puis, après soin, leur évacuation vers les grands hôpitaux fixes les plus proches). D’où la présence de chirurgiens dans les bataillons et les escadrons et d’équipes médicales de renforts au niveau des éléments de corps d’armée et d’armée (car on panse les blessés sur le champ de bataille, selon le principe de « médicalisation de l’avant » toujours en vigueur dans l’armée française). À cet égard, comme toutes les longues périodes de conflit, les guerres napoléoniennes sont à l’origine de quelques progrès touchant à la pratique chirurgicale.
Au bout du compte, les résultats de l’armée napoléonienne sont, dans le domaine de la santé, ni pires, ni meilleurs que ceux de ses adversaires. Il faut attendre la révolution pasteurienne et la vaccination pour voir le nombre de morts par maladie décroître proportionnellement dans les pertes (sachant que la puissance de feu accrue joue également son rôle dans cette nouvelle répartition des causes de décès)
FA : La cavalerie napoléonienne avait-elle une réelle valeur ajoutée si nous la comparons aux cavaleries des autres armées européennes ?
J-E.B : Matériellement, la cavalerie napoléonienne dispose de chevaux de moins bonne qualité que certains de ses adversaires (la cavalerie anglaise par exemple). Sa valeur tient probablement à ses structures, à la qualité de l’encadrement et à l’esprit d’initiative qui caractérise un certain nombre de généraux. Là encore, en rebattant complètement les cartes, la Révolution a permis l’émergence des meilleurs.
Si les pertes en chevaux sont énormes, les pertes en hommes dans la cavalerie le sont beaucoup moins. Les régiments conservent longtemps soldats et encadrement. Dès lors, l’entraînement, la pratique du cheval et l’expérience rendent les régiments de cavalerie globalement performants.
La personnalité des chefs de la cavalerie joue également. Murat, Bessières, Lassalle, d’Hautpoul, Marulaz ou Montbrun savent parfaitement manier tactiquement leurs unités et en tirer le parti maximum. Mais ils savent également improviser et prendre des initiatives au moment opportun. Ce commandement performant avec une troupe bien entraînée donne d’excellents résultats, souvent supérieurs à ceux de la cavalerie adverse. Le raid de la brigade Lassalle en 1806 est un modèle du genre.
La structure de la Grande Armée est également un avantage. Les corps d’armée disposent dans leurs rangs d’une à deux brigades de cavalerie légère qui leur permet d’éclairer leur marche et d’éviter les surprises. Mais le reste de la cavalerie est regroupée dans une entité de commandement particulière, la Grande réserve de cavalerie, articulée en divisions de cavalerie lourde (cuirassiers, carabiniers, voire dragons, appuyés d’artillerie à cheval) et divisions de cavalerie légère (hussards, chasseurs à cheval). La Réserve est généralement aux ordres de Murat, véritable magister equitum. Elle constitue une sorte de réservoir de forces, permettant de renforcer temporairement pour une mission un corps d’armée ou une paire de corps d’armée, durant une phase des marches d’approche ou de la poursuite. Ce système permet également de rationaliser l’emploi de la cavalerie (notamment la cavalerie lourde) un jour de bataille. L’absence de magister equitum à Waterloo est une des causes du gaspillage des régiments de cavalerie que Ney, chef d’état-major général, fait charger trop tôt de sa propre initiative.
Tout ceci mis bout à bout donne à la Grande Armée une bonne capacité à protéger ses flancs et à mener des reconnaissances durant ses marches d’approche ou à être en tête de la poursuite. Mais elle est également capable de remplir un véritable rôle tactique dans la manœuvre d’ensemble. En 1805, par exemple, la réserve de cavalerie assure la flanc-garde de la Grande Armée du 25 septembre au 8 octobre, durant la marche vers Ulm. Enfin, groupée, elle permet ponctuellement de mener une action de force : à Eylau, les charges des escadrons rétablissent la situation.
Mais la campagne de Russie, qui voit la destruction d’unités entières, modifie radicalement cet état de fait et marque un point de rupture. La disparition des combattants expérimentés ne peut être comblée qualitativement, si bien qu’à partir de 1813, la cavalerie napoléonienne (sauf la Garde ou les unités d’Espagne) n'est plus que l’ombre d’elle-même. Comme pour le reste de l’armée, les pertes moissonnent aussi progressivement les rangs de la haute hiérarchie : d’Hautpoul disparaît en 1807, Lassalle en 1809, Montbrun et Baraguey d’Hilliers en Russie, Bessières en 1813, Marulaz n’a plus de rôle actif après 1809.
Dans tous les cas, la cavalerie demeure seconde derrière l’infanterie tandis que l’arme qui monte en puissance au cours des campagnes demeure l’artillerie. Quoiqu’il en soit, les guerres napoléoniennes représentent en Europe la dernière occasion au cours de laquelle sont employées sur le champ de bataille de grandes masses de cavalerie. Puis les progrès de l’armement au milieu du XIXe siècle permettent de saturer un espace par le feu, ce qui rend inefficaces et très coûteuses les actions de force (la charge) : c’est l’exemple de la Brigade légère en Crimée ou des cuirassiers français à Reichshoffen. À partir de ce moment, la cavalerie devient une sorte d’infanterie montée qui se déplace plus vite que le fantassin « pur » mais ne charge plus en masse.
FA : Pour finir, quels sont les trois ou cinq meilleurs livres écrits par des soldats de Napoléon que vous recommanderiez ? Merci.
J-E.B : Tout dépend ce que l’on recherche. Pour revivre l’aventure militaire aux échelons inférieurs, voir les soldats vivre ou combattre, on peut se reporter aux classiques : Coignet (Les cahiers du capitaine Coignet), Parquin (Souvenirs du commandant Parquin), François (Le Journal d'un officier français ou Les Cahiers du capitaine François) ou Barrès (Souvenirs d’un officier de la Grande Armée). Les Mémoires de Marbot se lisent comme un véritable roman d’aventure, mais il faut bien avoir conscience que Marbot a « enjolivé ».
Les Souvenirs militaires de 1804 à 1814 de Fezensac sont également extrêmement intéressants. Compte tenu de la personnalité, de l’instruction et du milieu social de l’auteur, ils apportent une vision plus large sur les événements et les hommes que celle des troupiers de base.
En revanche, si l’on s’intéresse à la guerre et aux armées en tant qu’objet d’étude, deux ouvrages s’avèrent incontournables : Jomini bien sûr qui offre une analyse tactique sans égal mais aussi Marmont avec son Esprit des institutions militaires.
Propos recueillis par Franck Abed
le 26 juillet 2023
pour l’Institut MappaMundi
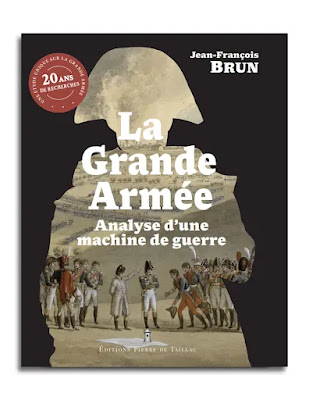


Commentaires
Enregistrer un commentaire